Roller et politique d’aménagement du territoire
Après un premier volet relatif à la perception du roller par le grand public, rollerenligne.com aborde un second thème dans la continuité : la place du roller dans la ville et en particulier de la place qui lui est faite dans les politiques d'aménagement du territoire...
Par alfathor

Le roller dans la ville : entre tolérance et rejet
 Le roller, comme de nombreuses autres pratiques de glisse urbaine telles que le skateboard, le BMX ou la trottinette, cherche sa place et une certaine légitimité dans le paysage urbain. Malheureusement, bien souvent, ces pratiques sont négligées dans les politiques d’aménagement des villes. Simple loisir ou véritables moyen de transport, le roller doit pouvoir trouver sa place au même titre que les autres activités sportives. Nous débutons cet article avec l’exemple du street (le plus emblématique), puis nous allons l’élargir aux autres pratiques du roller…
Le roller, comme de nombreuses autres pratiques de glisse urbaine telles que le skateboard, le BMX ou la trottinette, cherche sa place et une certaine légitimité dans le paysage urbain. Malheureusement, bien souvent, ces pratiques sont négligées dans les politiques d’aménagement des villes. Simple loisir ou véritables moyen de transport, le roller doit pouvoir trouver sa place au même titre que les autres activités sportives. Nous débutons cet article avec l’exemple du street (le plus emblématique), puis nous allons l’élargir aux autres pratiques du roller…
L’obtention d’un statut du patineur devrait favoriser l’intégration du roller
Peut-être sommes-nous un peu trop optimistes mais la future mise en place d’un statut pour les rollers d’ici fin 2009, en aménageant le code de la route, pourrait peut-être favoriser sa prise en compte par les décideurs.
Pour schématiser, le roller n’existe pas pour l’instant au regard de la loi ; pas vraiment cycliste, pas vraiment piéton, il ne trouve sa place nulle part.
Petit à petit, le roller trouve sa place
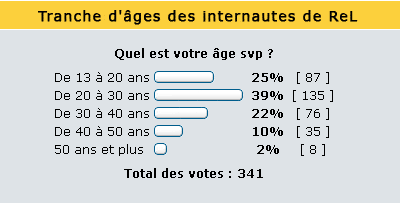
La tolérance envers les rollers a progressé depuis quelques années. La massification de la pratique a probablement favorisé sa compréhension par le plus grand nombre, même si ses codes restent difficiles à saisir. Entre 1.860.000 (INSEP, 2001) et 4.000.000 de personnes pratiqueraient le roller selon les différentes études parues depuis 10 ans. Les patineurs ne sont donc plus les marginaux ou les mauvais garçons des débuts.
La population des rollers regroupe quasiment autant d’hommes que de femmes, le patin recrute dans toutes les professions et catégories socio-professionnelles, même si la majorité des rouleurs sont des employés, des cadres et professions intermédiaires. Les enfants sont fortement représentés.
On peut toutefois constater que les réactions sont encore très contrastées selon les municipalités, allant du tout répressif au permissif…
Montpellier : une ville anti-rider ?
 Montpellier est un exemple intéressant, mêlant prévention, répression et aménagements dédiés.
Montpellier est un exemple intéressant, mêlant prévention, répression et aménagements dédiés.
Çà et là, au coeur de la cité languedocienne, se dressent des structures équipées de dispositifs anti-riders ou de panneau d’interdiction.
L’exemple le plus spectaculaire reste sans conteste le Corum, non loin du centre ville. Cet immense bâtiment moderne offre de nombreuses volées d’escaliers en marbre surmontées de mains courantes basses et parfaitement lisses. Autant dire que ce lieu est un paradis vraiment propice au street que ce soit en roller, skateboard ou BMX.
Aux traces qui couvrent les murs, on peut dire qu’il y a eu une période où le bâtiment n’était pas équipé de ces « empêcheurs de rider en rond ». Les marques indiquent clairement que les BMX ont causé quelques dégats. Les skateurs et les rollers n’ont laissé que quelques traces sombres sur les tranches des murets.
Aujourd’hui, les murets en marbres ont été taillés par la municipalité : des encoches profondes faites dans la pierre cassent les liaisons entre les blocs de marbres rendant ainsi les slides impossibles.
Sur les mains courantes, des pièces métalliques en forme de lune ont été soudées tous les mètres pour empêcher les glissades intempestives.
On peut aisément comprendre cette réaction parfaitement légitime de la mairie qui tient à préserver la qualité visuelle de l’édifice.
La question est alors de savoir : les riders disposent-ils d’un équipement adapté pour pratiquer ?
Oui et non. La ville de Montpellier possède l’un des plus beaux skateparks de la région au domaine de Grammont. Problème : l’équipement est à plusieurs kilomètres du centre-ville.
Les sports de glisse ne peuvent se passer du milieu urbain
Nous voici donc en face d’un cas très fréquent en France : une ville qui souhaite cantonner la pratique à un espace prédéfini, délimité, réglementé et excentré alors que l’essence même du roller ou du skateboard demande une pratique au coeur de la ville !
Le roller « street » est en majorité pratiqué par des enfants et des jeunes (entre 10 et 20 ans pour leur grande majorité). Comment vont-ils pouvoir se rendrent en périphérie de la ville ? Ce trajet est-il sécurisé ? Les parents vont-ils pouvoir accompagner leur enfants au skatepark chaque fois que ces derniers voudront pratiquer ?
De l’incompréhension naissent des réponses inadaptées ou incomplètes
Une profusion de parks en France

Les parks fleurissent dans les communes françaises. Nous en référençons plus de 3500 sur Rollerenligne.com, ce qui veut dire qu’au moins 10% des communes françaises en dispose.
Nous avons constaté que quasi-systématiquement, les skateparks sont placés près du stade municipal, dans le complexe sportif. Ces derniers, gourmands en espaces sont localisés en périphérie des villes.
La localisation des équipements : un enjeu stratégique
Les villes font un mauvais calcul en éloignant les lieux de pratiques des sports de glisse de leur centre : elles découragent ainsi fortement une pratique urbaine par essence et en progression constante.
Le park est, en général, placé aux confins de la ville, dans une zone industrielle, ou dans un quartier difficile où peu osent s’aventurer… pour ne pas troubler la quiétude du centre-ville. Les terrains y sont moins coûteux, les riders ne troublent pas l’ordre public de leurs exploits. L’endroit est rapidement laissé à l’abandon, dégradé, loin de tout. Si l’exemple est caricatural, il n’en reste pas moins fréquent.
Il faut dire que dans l’esprit des décideurs, habitués à une conception traditionnelle de la pratique sportive, le « réflexe » est logique : un sport, dans sa conception fédérale et compétitive, se pratique dans une enceinte close, clairement délimitée et réglementée. Les élus pensent ainsi répondre aux besoins des riders en leur proposant un lieu unique et dédié. Or, comme nous l’avons souligné dans notre article sur la perception du roller, les pratiquants sont des « nomades » par excellence.
Trop souvent, l’installation d’un park se fait dans une logique de canalisation d’une pratique dite « sauvage » et sans vraiment chercher à entendre les besoins réels des patineurs. Un équipement qui a coûté plusieurs dizaines de milliers d’Euros peut devenir un lieu fantôme.
On en arrive à des situations où la police réprimande les groupes de riders qui s’exercent sur une place en leur disant qu’un park à est disposition.
Les parks restent une solution incomplète
Nous venons de le dire, le « street » ne se limite pas à un seul lieu d’évolution : on peut aimer le park, mais aussi avoir l’envie de faire du street, passer d’un banc à un muret, à une volée de marche, tout en ridant dans un park…
Les contests de street « sauvages » sont légions : les riders se réunissent sur un spot, souvent un long rail ou un beau muret, ils y passent une heure puis filent vers un autre spot.
Quelle solution reste-il aux villes si les parks ne sont pas totalement adaptés aux pratiques de glisse urbaine ?
Intégrer les équipements « street » au coeur des villes

Il existe de nombreux espaces au coeur de la ville qui peuvent être aménagés : les espaces verts, les places, les escaliers ou encore les esplanades.
L’idée étant d’adapter le mobilier urbain déjà existant aux contraintes que lui font subir les riders : renforcer les murets avec des barres de métal (coping), aménager des mains courantes plus basses pour sécuriser la pratique, arrondir les bords de marches, créer des plans inclinés et des courbes, insonoriser les « modules », opter pour des revêtement lisses à la place des revêtements de trottoirs granuleux…
Le principe consiste à intégrer totalement l’espace de pratique, notamment les aires de street dans le paysage urbain… à tel point que les passants ne se rendent pas forcément compte que l’endroit est utilisable en roller, skateboard ou BMX.
Au final, le coût peut s’avérer inférieur à celui d’un park classique.
Si un projet demande un bugdet conséquent, il peut éventuellement être planifié sur plusieurs années. Pour les villes aux budgets plus modestes, la meilleure réponse à cette demande réside dans des micro-équipements de proximité : des bancs, des murets, capables d’encaisser les traitements infligés par les riders. Ils se fondent dans le paysage urbain, ne choquent pas les passants, et restent fonctionnels pour les riders. S’ils sont disséminés dans la ville, les patineurs nomades passeront de l’un à l’autre. Ils viendront en complément de n’importe quel skatepark.
Des solutions alternatives peuvent être trouvées : l’exemplarité de de Nantes
La ville de Nantes s’est dotée d’un park intégré dans le paysage urbain : la place Ricordeau siège au centre ville et propose des aménagements pensés pour accueillir les riders.
Les mains courantes sont basses, les murets sont rectilignes, accessibles et droits. Des courbes ont été dessinées, sécurisant l’ensemble. On pourrait dire que cette réalisation est une hybridation d’un park classique et du milieu « naturel » urbain. Ce genre de projets connaissent un succès grandissant dans le monde. Au Canada par exemple, des parks de ce type sont fabriqués dans des dimensions qui laisseraient rêveur la plupart des riders.
Les street-parks : une bonne piste à creuser

Le street-park est un concept qui consiste à intégrer un équipement dédié à la pratique du street en roller, skateboard ou BMX au coeur de la ville.
L’évaluation des besoins des pratiquants
La logique voudrait qu’une ville évalue les besoins de l’ensemble de ses administrés avant de mettre en place des équipements, qu’elle évalue les demandes de chacun et qu’elle cherche comment répondre au mieux aux aspirations du plus grand nombre quel que soit la pratique sportive considérée.
Sur le terrain, les choses ne se passent pas toujours ainsi.
L’absence de dialogue et de consultation des pratiquants peut entraîner des choix inadaptés comme un park avec des modules inadaptés : trop petits, trop hauts, trop près, plus adaptés au BMX qu’au roller ou au skate…
Plus grave, une ville peut installer un park alors que l’essentiel des pratiquants roller sont plutôt des randonneurs ou des slalomeurs, cela reviendrait à proposer à des footballeurs de jouer sur un terrain de tennis !
Les autres pratiques urbaines du roller
 Le roller regroupe diverses formes d’usages, comme nous l’avons souligné précédemment dans notre article dédié à la perception du roller. Les pratiques funs ne doivent pas être assimilées à des sports. Elles ne s’intègrent qu’en peu de points dans les cadres sportifs traditionnels. En cela, elles requièrent des équipements spécifiques et adaptés à ces nouvelles demandes.
Le roller regroupe diverses formes d’usages, comme nous l’avons souligné précédemment dans notre article dédié à la perception du roller. Les pratiques funs ne doivent pas être assimilées à des sports. Elles ne s’intègrent qu’en peu de points dans les cadres sportifs traditionnels. En cela, elles requièrent des équipements spécifiques et adaptés à ces nouvelles demandes.
Le slalom : une pratique populaire peu exigeante en équipements
Les slalomeurs sont plutôt bien perçus par le grand public. Ils animent les places, restent relativement discrets, peu bruyants et peu dangereux. Leurs plots de couleurs suscitent la curiosité des adultes comme des enfants. Ils ne dégradent pas les équipements. Pourtant, ils se font souvent refouler des places par incompréhension.
Cette pratique se fait rarement en solitaire ou dans des lieux déserts : le slalomeur a besoin de public. Souvent, les villes n’ont pas besoin de leur créer un équipement à proprement parler car les slalomeurs peuvent se poser à peu près n’importe où pour peu que le sol soit plat et lisse.
La randonnée, la vitesse, la longue distance : de l’amélioration des réseaux de pistes cyclables et de voies vertes
Les patineurs loisirs, de vitesse et autres randonneurs au long cours ont bénéficié du lobbying des cyclistes qui ont favorisé le développement des pistes cyclables et des voies vertes.
Pour des pratiques déambulatoires comme la randonnée, la construction et/ou la rénovation des pistes cyclables est une réponse adaptée à condition de mettre en place un réseau cohérent permettant de traverser la ville sans en toute sécurité. Idéalement, la piste cyclable ne sera pas une voie cyclable, elle sera séparée de la chaussée pour éviter toute intrusion des automobilistes peu scrupuleux. Ce réseau profitera également aux autres moyens de transports doux, favorisant le désengorgement du centre.
Il est primordial de penser à réaliser des voies suffisamment larges car l’encombrement d’un patineur est bien supérieur à celui d’un vélo : comptez 2 m environ !
D’autre part, les municipalités doivent systématiquement réfléchir au revêtement qu’elles choisissent quand elles aménagent leurs espaces. Pour le confort de pratique, des enrobés fins ou des dalles en béton lisse raviront les patineurs en plus des vélos et des autres usagers. Tout le monde y est gagnant !
En contre-exemple, on évitera les trottoirs en gravillon ou en béton striés, totalement impraticables…
L’essor des voies vertes
Les rollers ont largement bénéficié de l’essor des Voies Vertes qui se développent considérablement en France depuis une dizaine d’années.
L’impact économique et touristique de ces lieux de pratique s’avère non négligeable. Les Voies Vertes répondent aux attentes d’un grand nombre de pratiques de loisirs : cyclistes, rollers, handi-sport, piétons/randonneurs… Le succès de ces lieux est tel qu’il est parfois impossible de s’y déplacer le week-end. Là encore, les villes, départements et régions doivent prendre en compte la pratique du roller en privilégiant des enrobés fins en lieu et places de chemins de gravier. On veillera aussi à disposer régulièrement des points d’eau, des bancs et autres aires de pique-nique.
Là encore, les villes, départements et régions doivent prendre en compte la pratique du roller en privilégiant des enrobés fins en lieu et places de chemins de gravier. On veillera aussi à disposer régulièrement des points d’eau, des bancs et autres aires de pique-nique.
Le hockey
Les pratiques collectives « sauvages » comme le street-hockey se satisfont de terrains improvisés. Il suffit d’une surface plane et lisse, d’une halle de marché par exemple, d’une dalle, ou d’un ancien playground de basket ou de handball pour satisfaire les pratiquants.
Conclusion
La prise en compte du roller dans l’aménagement des villes requiert à la fois la mise en place d’équipements spécifiques réalisés en concertation avec les usagers, mais aussi l’adaptation de lieux déjà existants. Pour ces raisons, les projets d’aménagement doivent tenir compte du roller en amont pour réduire au maximum les coûts et contenter un grand nombre d’usagers.
Pour finir sur une note positive, on constate que de plus en plus de municipalités font appel à des cabinets spécialisés pour analyser la demande des pratiquants.
Galerie photos
|
|
|
Liens utiles
La notion d’aménagement du territoire sur Wikipedia
Le streetpark de Méry-sur-Oise (95)
Le bowl et le streetpark d’Annecy (74)
Photos : rollerenligne.com
Récréation Urbaine, droits réservés

Alfathor
21 avril 2009 at 11 h 12 minLe chemin sera long et difficile avant de voir fleurir des modules intégrés au paysage urbain de monsieur et madame Tout-le-monde. Il est vrai aussi que la création de skatepark est trés souvent motivé par le fait de pouvoir légitimer une limitation de pratique en dehors de celui-ci et venir enjoliver un CV de Maire en fin de mandat.
Pour être influent au niveau des pouvoirs publics il faut avant tout être représentatif et malheureusement à l'échelle de la population des grandes villes, quel est le pourcentage de ri
abdou
21 avril 2009 at 10 h 44 min